Polisse : pour que l’enfance gagne
paquita | 12 mai 2015 C’est dans le titre du film que s’inscrit son thème : l’enfance. Mais une enfance maltraitée par une société malade.
C’est dans le titre du film que s’inscrit son thème : l’enfance. Mais une enfance maltraitée par une société malade.
Filmée à la manière d’un documentaire, cette fiction qui s’inspire de faits réels transporte son spectateur dans une zone inconnue du “fait divers” et de notre système judiciaire : celle de la BPM ou Brigade de Protection des Mineurs. Les destins des enfants de tous milieux sociaux-culturels y croisent le quotidien d’agents de police impliqués presque, au-delà de la raison. On y découvre la fragilité d’une parole d’enfant qu’il faut décrypter face à celle d’un agresseur sexuel dont il faut confirmer ou infirmer la culpabilité. La parole d’une maman sans domicile fixe, qui vient « livrer » son enfant dans l’espoir qu’on lui trouve un foyer d’accueil. Ou encore celle d’une jeune pickpocket d’origine Rom, victime des coups de son oncle et de l’omerta de sa communauté. La force du film c’est aussi de montrer l’escalade de l’irrespect, dans les mots et la pensée des adolescents à l’encontre des représentants de l’ordre, sans jugement, comme un état des lieux d’une société qui se durcit, qui mute. Ce qui offre des scènes à la fois surréalistes et hilarantes car en dépit de la gravité du thème, le rire est une soupape nécessaire, vitale.
Dans BPM, il y a « protection » et c’est de là que naît le quiproquo. Protéger, prévenir, réprimer, punir, réconforter, c’est tout ça à la fois qu’il faut vivre et exercer chaque jour. Comment supporter les drames, les horreurs parfois, où trouver les ressources pour continuer le combat contre l’injustice pour qu’enfin, ce soit l’enfance qui gagne.
Article paru sur le site Internet de la médiathèque de Montrouge et dans le dernier Montrouge Magazine (avec quelques modifications).
 Primé en 2011 au festival de Cannes, ce film à l’esthétique épurée et contemplative n’a pas usurpé son prix de la mise en scène.
Primé en 2011 au festival de Cannes, ce film à l’esthétique épurée et contemplative n’a pas usurpé son prix de la mise en scène.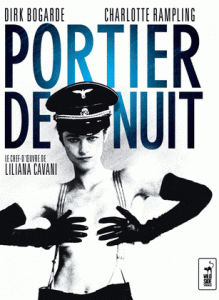
 Article paru dans le n° 92 de
Article paru dans le n° 92 de 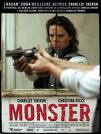 Monster est un film de femmes, réalisé par une femme, Patty Jenkins, mais avec une portée universelle. Il soulève, au-delà du fait-divers sordide, des problématiques économiques et sociales qui entraînent inévitablement, leur cortège de misères affectives et de destruction.
Monster est un film de femmes, réalisé par une femme, Patty Jenkins, mais avec une portée universelle. Il soulève, au-delà du fait-divers sordide, des problématiques économiques et sociales qui entraînent inévitablement, leur cortège de misères affectives et de destruction. Ici il faut souligner l’ incarnation magistrale de Charlize Théron, légitimement récompensée en 2003 pour ce rôle hors-norme. Servie par une métamorphose physique stupéfiante, elle s’accorde parfaitement avec l’interprétation de cette femme aux blessures multiples, à vif et pourtant débordante d’énergie. Bourrée de contradictions et d’un mal de vivre que l’abus d’alcool n’apaise en rien, elle n’en est pas moins pourvue d’une logique qui est celle de la rue et de la survie. Dans une scène particulièrement symbolique, elle développe en termes poignants et parfaitement intelligibles, sa ”théorie” du meurtre, laquelle se fonde sur son expérience de l’homme, balayant une moralité ou une conscience dont ces derniers, par machisme ou hypocrisie chrétienne, se seraient défaits. Pendant toute la durée du film, c’est Aileen que nous voyons évoluer, se malmener et malmener les autres, se battre avec une intelligence forgée dans la violence et la solitude, aimer avec l’abnégation des gens de foi et le fanatisme d’un manque affectif abyssal. A aucun moment, la réalisatrice ne sera tentée de la rendre moins abîmée à l’image, un peu plus attrayante. L’intégrité fut, semble-t-il, l’attitude-reine de ce tournage et confère au film une force d’attraction peu commune.
Ici il faut souligner l’ incarnation magistrale de Charlize Théron, légitimement récompensée en 2003 pour ce rôle hors-norme. Servie par une métamorphose physique stupéfiante, elle s’accorde parfaitement avec l’interprétation de cette femme aux blessures multiples, à vif et pourtant débordante d’énergie. Bourrée de contradictions et d’un mal de vivre que l’abus d’alcool n’apaise en rien, elle n’en est pas moins pourvue d’une logique qui est celle de la rue et de la survie. Dans une scène particulièrement symbolique, elle développe en termes poignants et parfaitement intelligibles, sa ”théorie” du meurtre, laquelle se fonde sur son expérience de l’homme, balayant une moralité ou une conscience dont ces derniers, par machisme ou hypocrisie chrétienne, se seraient défaits. Pendant toute la durée du film, c’est Aileen que nous voyons évoluer, se malmener et malmener les autres, se battre avec une intelligence forgée dans la violence et la solitude, aimer avec l’abnégation des gens de foi et le fanatisme d’un manque affectif abyssal. A aucun moment, la réalisatrice ne sera tentée de la rendre moins abîmée à l’image, un peu plus attrayante. L’intégrité fut, semble-t-il, l’attitude-reine de ce tournage et confère au film une force d’attraction peu commune. Habituellement, je n’aime pas les comédies musicales pour bambins : c’est hystérique, mièvre et ça fait du bruit. Je n’avais donc jamais vu ce film (sorti en 1964) et m’en faisait une idée calquée sur mes préjugés : cul-cul la praline, vieillot, probablement moraliste, etc. Mais à mon grand étonnement j’ai découvert une véritable perle ! Il y a bien un miracle Mary Poppins, une étonnante alchimie qui opère et vous fait redevenir enfant, comme si vous n’aviez jamais quitté cet état.
Habituellement, je n’aime pas les comédies musicales pour bambins : c’est hystérique, mièvre et ça fait du bruit. Je n’avais donc jamais vu ce film (sorti en 1964) et m’en faisait une idée calquée sur mes préjugés : cul-cul la praline, vieillot, probablement moraliste, etc. Mais à mon grand étonnement j’ai découvert une véritable perle ! Il y a bien un miracle Mary Poppins, une étonnante alchimie qui opère et vous fait redevenir enfant, comme si vous n’aviez jamais quitté cet état. L’ange de la vengeance (Ms.45 en anglais) est un film au climat hypnotique et envoûtant. Il représente bien plus qu’un simple film de genre, ici sous-genre du “film d’autodéfense”. Sorti sur les écrans en 1982, le troisième long-métrage d’Abel Ferrara, cinéaste indépendant et underground, est une de ces pépites que seul le cinéma américain peut produire. Viscéral et singulier au coeur même de la contre-culture, il se détache par une esthétique évoquant celle de Taxi Driver ou Permanent Vacation (les couleurs, la mythologie de la ville, la codification des personnages) et par l’originalité du scénario (une jeune-fille violée qui met en oeuvre sa propre vendetta). On y trouve de la violence certes, mais surtout une vengeance qui ne dit pas son nom (l’héroïne est muette) vue et mise en scène par le prisme paranoïaque de cet ange exterminateur, dont la destinée mortelle s’inscrit jusque dans le prénom…
L’ange de la vengeance (Ms.45 en anglais) est un film au climat hypnotique et envoûtant. Il représente bien plus qu’un simple film de genre, ici sous-genre du “film d’autodéfense”. Sorti sur les écrans en 1982, le troisième long-métrage d’Abel Ferrara, cinéaste indépendant et underground, est une de ces pépites que seul le cinéma américain peut produire. Viscéral et singulier au coeur même de la contre-culture, il se détache par une esthétique évoquant celle de Taxi Driver ou Permanent Vacation (les couleurs, la mythologie de la ville, la codification des personnages) et par l’originalité du scénario (une jeune-fille violée qui met en oeuvre sa propre vendetta). On y trouve de la violence certes, mais surtout une vengeance qui ne dit pas son nom (l’héroïne est muette) vue et mise en scène par le prisme paranoïaque de cet ange exterminateur, dont la destinée mortelle s’inscrit jusque dans le prénom… Ok, je suis fan de Joy Division. Ce n’est cependant pas une raison pour avaler tout et n’importe quoi, dans l’espoir de ressusciter le cadavre… Bon, Control, ça n’est pas n’importe quoi et pour cause. L’exercice fut hautement périlleux : adapter au cinéma le récit de la vie d’un chanteur de rock mort à 24 ans, conjointement à la naissance d’un groupe qui deviendra culte et intronisera du même coup un genre à part entière : la Cold Wave.
Ok, je suis fan de Joy Division. Ce n’est cependant pas une raison pour avaler tout et n’importe quoi, dans l’espoir de ressusciter le cadavre… Bon, Control, ça n’est pas n’importe quoi et pour cause. L’exercice fut hautement périlleux : adapter au cinéma le récit de la vie d’un chanteur de rock mort à 24 ans, conjointement à la naissance d’un groupe qui deviendra culte et intronisera du même coup un genre à part entière : la Cold Wave.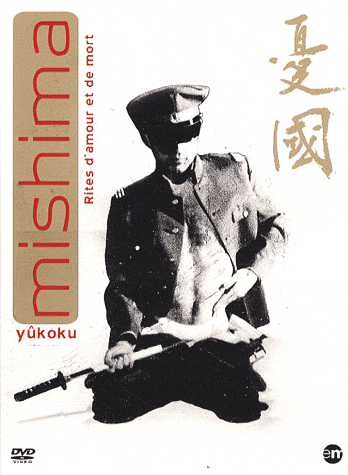 Faut-il encore présenter le sulfureux Mishima ? Kimitake Hiraoka (1925-1970) de son vrai nom, se révéla au grand public avec un roman décadent : “Confessions d’un masque” (1947). Le personnage principal, double de Kimitake, tente d’y mettre à nu les désirs contradictoires qui l’animent, entre passion charnelle homosexuelle et rigidité de l’èthos samouraï. Outre le champ littéraire (romans, nouvelles, essais, theâtre) Mishima investit aussi celui de la photographie . Dans “Ba-ra-kei : Ordeal by Roses” Mishima se met en scène, photographié par Eikoh Hosoe. Fasciné par le martyre de Saint-Sébastien, l’écrivain y incarne les prémisses de l’esthétique gay : hypervalorisation de la musculature masculine, vitalité de la jeunesse magnifiée par la souffrance, désir de mort. Ces préoccupations érotico-existentielles ne sont pas sans évoquer celles du Japon contemporain, révélées par le travail de nombreux artistes, comme celui du photographe Nobuyoshi Araki par exemple, adepte du bondage et obsédé par le temps. Mishima l’homme de lettres fut aussi acteur, notamment pour Yasuzo Masumura dans “Le gars des vents froids” et l’on adapta nombre de ses fictions au cinéma.
Faut-il encore présenter le sulfureux Mishima ? Kimitake Hiraoka (1925-1970) de son vrai nom, se révéla au grand public avec un roman décadent : “Confessions d’un masque” (1947). Le personnage principal, double de Kimitake, tente d’y mettre à nu les désirs contradictoires qui l’animent, entre passion charnelle homosexuelle et rigidité de l’èthos samouraï. Outre le champ littéraire (romans, nouvelles, essais, theâtre) Mishima investit aussi celui de la photographie . Dans “Ba-ra-kei : Ordeal by Roses” Mishima se met en scène, photographié par Eikoh Hosoe. Fasciné par le martyre de Saint-Sébastien, l’écrivain y incarne les prémisses de l’esthétique gay : hypervalorisation de la musculature masculine, vitalité de la jeunesse magnifiée par la souffrance, désir de mort. Ces préoccupations érotico-existentielles ne sont pas sans évoquer celles du Japon contemporain, révélées par le travail de nombreux artistes, comme celui du photographe Nobuyoshi Araki par exemple, adepte du bondage et obsédé par le temps. Mishima l’homme de lettres fut aussi acteur, notamment pour Yasuzo Masumura dans “Le gars des vents froids” et l’on adapta nombre de ses fictions au cinéma.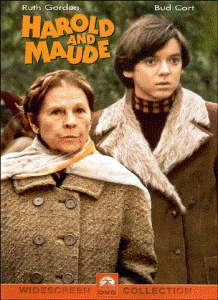
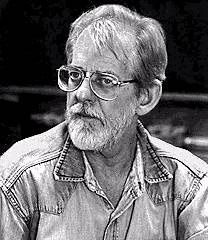 l’épanouissement d’Harold viendra illuminer les derniers jours de Maude et Maude permettra à Harold de trouver en lui-même, un sens à sa vie. Enfin, il faut saluer les prestations exceptionnelles de Ruth Gordon aujourd’hui décédée, de Bud Cort son partenaire, ainsi que le talent du réalisateur également disparu, qui su mener ce récit original à son terme, en apportant un soin particulier à la composition des images. “Harold et Maude” est et demeurera un film important.
l’épanouissement d’Harold viendra illuminer les derniers jours de Maude et Maude permettra à Harold de trouver en lui-même, un sens à sa vie. Enfin, il faut saluer les prestations exceptionnelles de Ruth Gordon aujourd’hui décédée, de Bud Cort son partenaire, ainsi que le talent du réalisateur également disparu, qui su mener ce récit original à son terme, en apportant un soin particulier à la composition des images. “Harold et Maude” est et demeurera un film important.




